
Le 28 avril 1789, les hommes à bord du H.M.S. Bounty, un navire de la marine britannique commandé par le capitaine William Bligh, ont organisé une mutinerie légendaire. Après avoir passé plusieurs mois idylliques sur l’île de Tahiti, ces hommes souhaitaient établir une colonie au sein du Pacifique Sud.

William Bligh, le capitaine du Bounty.
Un voyage homérique
Lorsque le H.M.S. Bounty quitta l’Angleterre en novembre 1787, ni son capitaine ni son équipage ne pouvaient se douter que leur paisible voyage se terminerait devant la cour martiale et aurait pour conséquence des générations de colons sur Tahiti, une île lointaine du Pacifique Sud.
Cap vers l'île de Tahiti
Le Bounty était une frégate de la Royal Navy. Sa mission était de collecter des plants d’arbre à pain à Tahiti puis de les transporter dans les Indes occidentales britanniques où ils serviraient de nourriture aux esclaves.
Le vétéran capitaine William Bligh avait été chargé d’effectuer un voyage pour récolter des fruits et des plans de l’arbre à pain (Uru en Tahitien), une variété de fruits tropicaux au goût de figue. La Couronne britannique voyait là des rations nutritives et bon marché pour les esclaves des plantations de canne à sucre des Antilles britanniques.
Pour cette mission pacifique, à son bord, quarante-six hommes, dont deux botanistes, mais aucun officier hormis Bligh. Le navire voguait seul, sans la protection d’un autre bateau de la Royal Navy. Bligh prévoyait un voyage paisible jusqu’à Tahiti, que le capitaine James Cook avait visitée en 1769. L’île était vue par les marins britanniques comme un paradis riche en fruits à pain.
Après une traversée de près d’un an et dix jours sous la tempête, le navire arriva à Tahiti en octobre 1788 et y fit escale pendant cinq mois. L’île était aussi paradisiaque que ce que l’équipage imaginait. Ils en profitèrent pleinement. Les marins s’adonnèrent à une vie agréable et beaucoup nouèrent des liens avec les habitants. Ils établirent également des liens avec les femmes de l’île, qui leur échangeaient des faveurs sexuelles contre certains objets, comme des clous. Le jour, l’équipage récoltait les fruits à pain et s’occupait des plants. La nuit, ils s’amusaient. Cette vie paradisiaque eut pour corollaire la dégradation des relations entre l’équipage, les officiers et le capitaine Bligh.
L’origine de la mutinerie
Lorsque le Bounty reprit le large le 1er avril 1789, l’idée d’une mutinerie avait déjà germé dans l’esprit de l’équipage. Les marins manifestèrent leur hostilité quand le capitaine Bligh, s’efforçant de rétablir la discipline, se montra de plus en plus sévère. Malgré l’amitié initiale de Christian avec le capitaine Bligh, au fil de la navigation leurs relations se tendirent. Au cours du voyage, le capitaine se montrait « critique, insultant, mesquin et condescendant. Il fit de Fletcher Christian un bouc émissaire, le punissant devant tout l’équipage. Le 27 avril, il accusa Christian d’avoir volé la réserve de noix de coco du navire et punit l’ensemble de l’équipage pour ce vol. Trois semaines après le départ de Tahiti, il fomenta une mutinerie à laquelle participèrent plus de la moitié des marins.
Bien que la véritable cause de la mutinerie soit toujours discutée par les historiens, il leur semble clair que pour Christian, l’accusation de son capitaine fut le coup de grâce. Le 28 avril, un groupe de révoltés commandés par Christian s’armèrent des mousquets qui se trouvaient sur le Bounty pour débarquer dans la cabine de Bligh et le faire prisonnier. Christian aurait déclaré à Bligh « Je suis en enfer depuis des mois avec toi ».
Puis vint le chaos. L’équipage du navire se divisa en deux factions : l’une fidèle à Bligh, l’autre déterminée à déserter. Les vingt-trois mutins isolèrent le capitaine ainsi que dix-huit autres hommes sur un bateau. Ils leur donnèrent quelques rations et un sextant pour les aider à la navigation, après quoi ils envoyèrent le bateau au large. Le Bounty était aux mains des rebelles.
Christian et son équipage, qui comprenait quelques otages encore fidèles à Bligh, souhaitaient établir une colonie. Ils jetèrent leur dévolu sur Tubuai, l’île des Tonga, à plus de 600 km au sud de Tahiti. Ils y rencontrèrent un groupe de natifs hostiles, qu’ils tuèrent. Ils retournèrent à Tahiti en quête de travailleurs et de ravitaillement. Les rebelles maquillèrent leur mutinerie et mentirent au sujet de leur mission car ils étaient certains que les chefs tahitiens, entretenant de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, auraient refusé de les aider en apprenant ce qu’il s’était passé. Les Britanniques repartirent ainsi à Tubuai avec trente Tahitiens. Les hostilités avec les insulaires et les divisions au sein de l’équipage s’aggravèrent jour après jour. Les hommes abandonnèrent bientôt la lutte pour s’établir à Tubuai.
Lorsque les révoltés revinrent à Tahiti, ils découvrirent que leur mensonge avait été dévoilé. Pensant qu’une nouvelle mutinerie se préparait, Christian, désespéré, attira un groupe de Tahitiens à bord du Bounty pour festoyer, avant de les faire prisonniers et de mettre les voiles. Seize marins britanniques furent abandonnés à Tahiti.
Parallèlement, Bligh et ses fidèles poursuivaient leur voyage effréné de leur côté. En premier lieu, ils se dirigèrent vers une autre île des Tonga. Ils la quittèrent rapidement après la rencontre hostile avec ses occupants, qui lapidèrent le quartier-maître du navire. Les rations s’amenuisaient. L’équipage décida donc de mettre le cap vers une colonie hollandaise à Timor, à plus de 6 000 km de là. Après quarante-sept jours, ils débarquèrent et dévoilèrent la mutinerie à la Couronne.
Plusieurs marins périrent sur le voyage de retour vers l’Angleterre mais Bligh, lui, survécut. « J’ai perdu le Bounty », écrivit-il à sa femme juste avant son départ pour le Royaume-Uni. « Ma conduite a été exemplaire, et j’ai montré à tous que, dévoué comme je l’ai été, j’ai défié tous les ennemis de me faire du mal. »
L’après-coup
À son arrivée, Bligh fut traduit en cour martiale pour avoir abandonné son navire et acquitté. Le H.M.S. Pandora prit la mer depuis l’Angleterre avec pour mission de capturer les mutins. Lorsque l’équipage débarqua à Tahiti en mars 1791, ils firent quatorze mutins prisonniers, que Christian avait abandonnés. Le Pandora coula peu après, après avoir percuté la Grande Barrière de corail. Quatre des captifs encore enchaînés se noyèrent.
En septembre 1792, les dix hommes de retour sur le sol anglais furent jugés en cour martiale. En vertu de la législation anglaise, tout homme resté sur le navire était reconnu coupable de mutinerie, qu’il y eût participé activement ou non. Quatre des mutins furent acquittés, les six autres condamnés à mort par pendaison. Trois des six condamnés furent finalement graciés. Les trois restants, Thomas Burkett, John Millward, et Thomas Ellison, furent pendus le 29 octobre 1794.
Entre-temps, le reste des mutins et leurs prisonniers tahitiens avaient trouvé un refuge au sein de l’île Pitcairn, perdue dans le Pacifique Sud. Cette île déserte et verdoyante avait tout d’un paradis. Les révoltés y brûlèrent rapidement le Bounty et s’établirent sur place.
Toutefois, les tensions qui avaient gâché leur voyage persistaient sur l’île. Les Tahitiens que les mutins avaient faits captifs reprochaient aux Britanniques d’avoir abusé de leurs femmes, qu’ils avaient traitées comme des objets sexuels. Tevarua, une Tahitienne, se serait même donné la mort suite aux violences qu’elle avait subi. En septembre 1793, les Tahitiens assassinèrent quatre des huit mutins, dont Christian. Au cours de la décennie suivante, tous les révoltés moururent, à l’exception de John Adams.
Les descendants des mutins s’établirent sur l’île Pitcairn, l’abandonnant à de multiples reprises avant d’y revenir en quête de provisions et de terres à cultiver. Ils vivent toujours sur la petite île aujourd’hui, considérée comme un territoire britannique d’outre-mer peuplé par une cinquantaine de personnes. En 1957, Luis Marden, explorateur National Geographic, retrouva les vestiges du Bounty, tout du moins, ce qu’il en restait, au large de la côte est de l’île.
Aujourd’hui, l’histoire du Bounty reste dans les mémoires en raison de la place notoire qu’il tient dans le passé colonial de la Grande-Bretagne, mais aussi pour son caractère dramatique. En 2017, l’historienne Diana Preston s’est confiée à National Geographic. Entre les maladies, le débarquement des missionnaires de Christian et l’exploitation sexuelle des femmes, les explorateurs européens ont « en effet détruit tout ce que les gens avaient trouvé d’exotique et d’attrayant dans la culture tahitienne ».
HMS Bounty
His Majesty’s Armed Vessel (HMAV) Bounty ou Her Majesty’s Ship (HMS) Bounty était à l’origine un charbonnier appelé Bethia qui fut construit dans le chantier naval Blaydes de Kingston dans le Yorkshire en 1784 ; le navire fut renommé en après son acquisition par la Royal Navy pour la somme de 1 950 livres. Le vaisseau était un trois-mâts de 28 mètres de long pour une largeur de 7,6 mètres et un tonnage de 230 tonneaux. Son armement se composait de quatre canons de quatre livres sur affût et de dix pierriers d’une demi-livre sans compter les mousquets emportés par l’équipage. Étant donné qu’il était enregistré à l’Amirauté comme un cotre — le plus petit rang utilisé par la Royal Navy —, le Bounty était commandé par un lieutenant plutôt que par un capitaine et ce dernier était également le seul officier à bord. De plus, les cotres n’embarquaient pas l’habituel détachement de Royal Marines utilisés par les commandants pour se faire obéir.
Le Bounty avait été acheté pour transporter des plants d’arbre à pain depuis l’île polynésienne de Tahiti dans le Pacifique sud jusqu’aux colonies britanniques dans les Indes occidentales. L’expédition était soutenue par la Royal Society et fut organisée par son président Joseph Banks afin de fournir une nourriture à bon marché aux esclaves (Banks possédait des plantations de canne à sucre à la Jamaïque). Pour cette mission, le Bounty fut modifié sous la supervision de Banks au chantier naval de Deptford sur la Tamise. La grande cabine formant habituellement les quartiers du capitaine fut transformée en une serre capable d’accueillir plus d’un millier de plants en pot. Cette réduction d’espace signifiait que l’équipage, les officiers mariniers et le commandant devraient supporter une grande promiscuité durant les longs mois de traversée.
Pourquoi le Bounty Lodge ?
D’abord parce que le HMS Bounty à jeté l’ancre dans la baie située en face du Bounty Lodge au PK5 à Arue, puis en clin d’oeil au co-auteur du livre « Les révoltés du Bounty » James Norman Hall, qui a demeuré dans la propriété qui jouxte le Bounty Lodge.
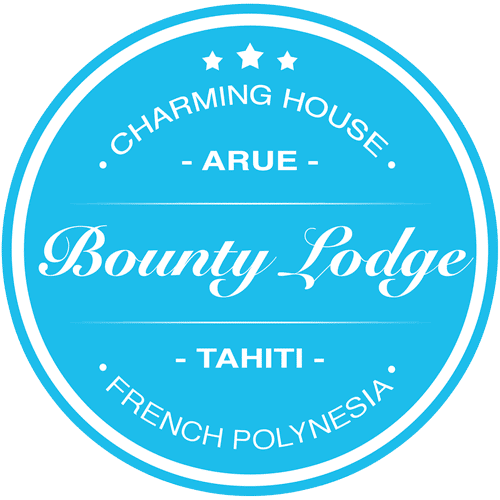
Servitude Paruau – Arue – PK5
Tahiti – Polynésie française
Services additionnels
Paiement par carte bancaire avec Paiement Sécurisé Systempay

Paiement sécurisé par crypto-monnaie avec Coinbase Commerce

Bounty Lodge ® Marque déposée – Tous droits réservés – Réalisé par Tahiticom










